En vous abonnant, vous accéderez à tous les articles, enquêtes exclusives et vous recevrez même un cadeau...
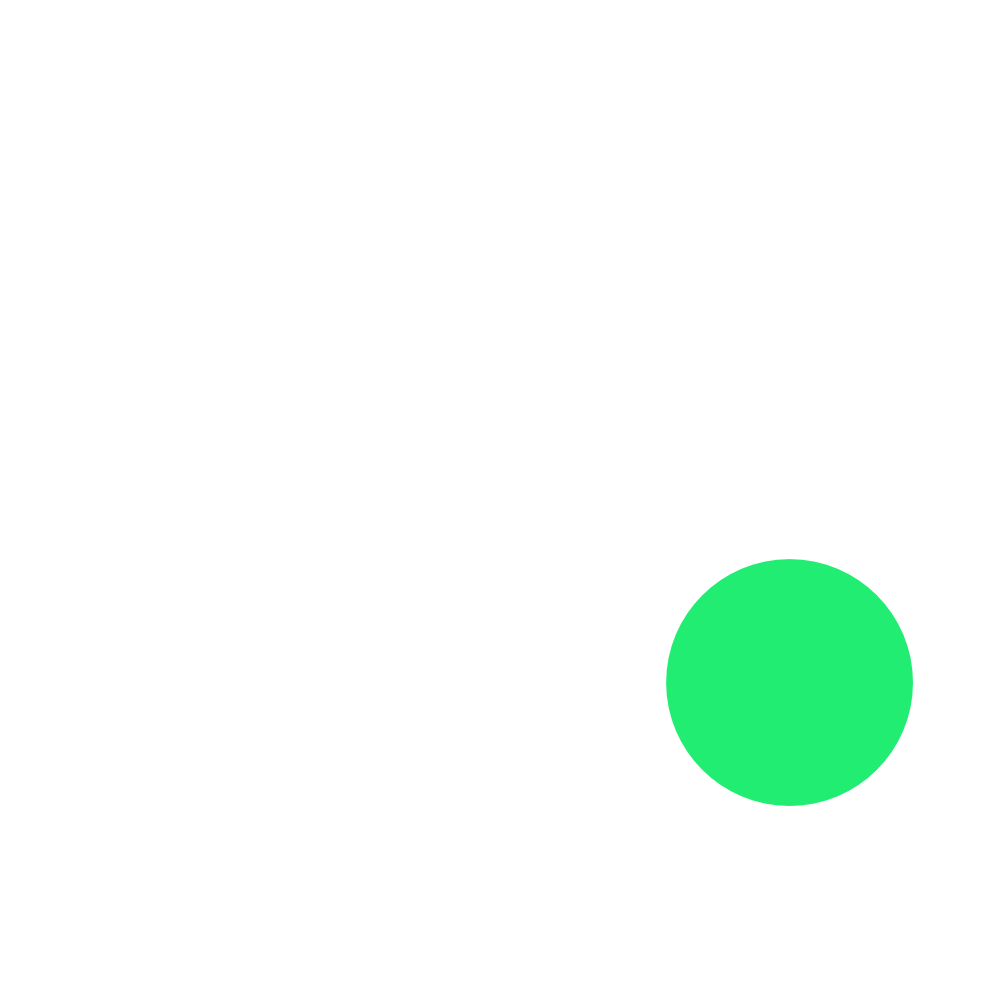
Simone Weil : Et si la démocratie commençait par la fin des partis politiques ?
Simone Weil : Et si la démocratie commençait par la fin des partis politiques ? , le décryptage, le décryptage.fr, ledecryptage, ledécryptage, site, média, presse, news, conflit, guerre, fait-divers, info, journal, économie, justice, decrypt, décrypte, décryptons
Par Yanis •

Tout d’abord, avant d’aborder l’analyse de cette question du point de vue de Simone Weil, il convient de noter que, bien que Simone Weil donne un avis clairement tranché sur cette question, elle ne propose pas d’alternatives concrètes aux partis politiques. Néanmoins, sa question reste intéressante et surtout légitime, du fait de la défiance actuelle de la population française envers les partis politiques.
Simone Weil est une philosophe française née en 1909. Militante anarchiste, toute sa vie sera marquée par un engagement sans pareil auprès des plus démunis. Grande figure du militantisme, sa pensée doit être prise au sérieux, car elle est l’une des rares à avoir produit une théorie issue directement de la pratique et de l’expérience vécue au sein des mouvements ouvriers. Sa réflexion, en dehors de tout cadre purement théorique, s’inscrit dans une compréhension de la société à travers sa propre expérience personnelle.
Avant de commencer l’analyse, il est bon de rappeler ce qu’est un parti politique :
Un parti politique est un « groupe de personnes qui partagent les mêmes intérêts, les mêmes opinions, les mêmes idées, et qui s’associent dans une organisation ayant pour objectif de se faire élire et d’exercer le pouvoir ».
Dans son ouvrage Note sur la suppression des partis politiques (1950), Simone Weil se prononce en faveur de la suppression des partis politiques. Selon elle, ces derniers portent en eux le « germe du totalitarisme ». Ils ne sont pas conformes au « bien » (le bien étant, selon Simone Weil, la vérité et la justice), car ils favorisent le mensonge et aliénent la raison.
« Un parti politique est une organisation construite de manière à exercer une pression collective sur la pensée de chacun des êtres humains qui en sont membres. »
(Note sur la suppression des partis politiques, 1950)





